Dans un article pour “The Conversation”, la chercheuse Marie Jauffret-Roustide analyse les traitements différents dans les discours publics de la cocaïne 🥂, drogue perçue comme « festive », et du crack 💔, associé à la marginalité, bien qu’il s’agisse également de cocaïne.
La cocaïne, un produit de sociabilité
Depuis le début du XXe siècle, on associe souvent la cocaïne à des imaginaires liés à la sociabilité, à la fête 🎉 et à la vie nocturne 🌙.
Le crack, une autre vision
Le crack 🔥, n’est rien d’autre qu’un dérivé de la cocaïne, à laquelle on ajoute du bicarbonate ou de l’ammoniaque pour le consommer par inhalation. Son image est pourtant tout autre : « contrairement aux descriptions des consommateurs de cocaïne, qui dépeignent des publics issus des classes sociales favorisées blanches », « les usagers de crack sont le plus souvent traités comme un groupe anonyme ».
Dans un article pour The Conversation, Marie Jauffret-Roustide, chercheuse à l’INSERM, explique comment les débats publics traitent la cocaïne et le crack.
Elle aborde également la manière dont ces discours se traduisent sur le plan des politiques publiques et leurs conséquences pour les consommateurs de crack, auprès desquels elle a travaillé.
Cliquez sur le lien Facebook : La cocaine
L’affaire Pierre Palmade, les scènes ouvertes de crack dans le nord-est de Paris… Ces dernières années, la cocaïne et le crack ont défrayé la chronique.
Malgré leur proximité pharmacologique, ces deux drogues font l’objet de traitements très différents, du point de vue médiatique, mais aussi politique et symbolique. Alors que la cocaïne, bien que prohibée, est considérée comme une drogue « festive », le crack est associé aux imaginaires de la violence et à la précarité.
Des traitements médiatiques et politiques divergents
Ce qui a notamment des conséquences sur les politiques publiques destinées à encadrer la situation vis-à-vis du crack, lesquelles se résument souvent à « éloigner et enfermer » 🚨. Pourquoi de telles différences ? Vers quelles politiques publiques se tourner pour dépasser cette vision binaire, dans l’intérêt de tous ?
Cocaïne et crack, deux drogues intimement liées
La cocaïne provient de la feuille de coca, une plante d’Amérique du Sud 🌱 utilisée pour ses propriétés stimulantes.
En 1860, le chimiste Albert Niemann isole pour la première fois la cocaïne. C’est aussi au XIXe siècle que cette substance commence à se diffuser sur le marché européen. Consommée comme drogue dès le début du siècle dernier, la cocaïne est généralement associée à des imaginaires de sociabilité, de fête et de vie nocturne.
Certes, les discours médiatiques véhiculent l’idée que la consommation de cette substance progresse dans la population, et que « tous les Français pourraient être concernés ». Cependant, des témoignages personnels d’artistes renforcent l’image d’une drogue festive, et lui confèrent une dimension humaine.
Le crack, en revanche, n’a pas cette image ; il est associé aux marges de la société. Lorsque des témoignages de consommateurs arrivent dans les médias, ils restent le plus souvent anonymes et déshumanisés. Pourtant, du point de vue pharmacologique, il n’est pas si éloigné de la cocaïne, dont il dérive (il est obtenu à partir de cette dernière par adjonction d’ammoniaque ou de bicarbonate).

Généralement fumé, ses effets sont certes plus rapides et plus puissants que ceux de la substance dont il provient. Mais la différence, dans les imaginaires sociaux, entre cette « cocaïne du pauvre » (l’un des surnoms du crack) et la cocaïne ne tient pas tant aux effets des substances en elles-mêmes qu’aux caractéristiques sociales et ethnoraciales des publics qui les incarnent.
Le crack, drogue de l’animalité et de la folie ?
Le crack est arrivé en France à la fin des années 1980, dans le sillage des États-Unis, avec des imaginaires sociaux liés à la précarité sociale, à la communauté afro-américaine et à la guerre des gangs.
Cette nouvelle drogue a rapidement donné lieu à des discours relevant de la « panique morale », dans lesquels le crack était « diabolisé ». Au fur et à mesure que le crack se diffusait en France, son traitement médiatique et politique a produit des imaginaires dévalorisants, renvoyant à l’animalité et la folie.
Les articles dépeignaient une drogue rendant « accro » dès la première prise, relataient des actes de violence commis « sous l’emprise du crack », présentaient les « crack babies », des bébés dépendants au crack dès leur naissance.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Au-delà de ce discours médiatique sensationnaliste et déshumanisant, d’autres enjeux politiques peuvent aussi expliquer, dans une certaine mesure, la mauvaise image de cette substance.
Un motif de contrôle social
La lutte contre les drogues peut servir de prétexte pour atteindre d’autres fins politiques, comme le contrôle social 🛑 de groupes perçus comme dangereux ⚠️.
Ainsi, on peut interpréter le caractère répressif de la loi du 31 décembre 1970 régissant l’usage de drogues en France comme une volonté de contrôler les jeunes contestataires 👥 de mai 68. De l’autre côté de l’Atlantique, on a analysé la guerre contre la drogue 💥 menée aux États-Unis comme une volonté de réprimer les communautés afro-américaines ✊ par leur incarcération massive, selon Michelle Alexander, activiste et spécialiste des droits civiques, dans son ouvrage The New Jim Crow.
Cette dimension de contrôle social s’incarne ainsi dans le différentiel des sanctions proposées aux États-Unis : jusqu’en décembre 2022, les peines étaient beaucoup plus lourdes pour les usagers de crack 💣.
Deux drogues, deux discours publics
En France, les discours publics sur la problématique du crack 💥 se construisent en miroir des représentations dévalorisantes dont cette drogue fait l’objet. Les médias 📰 et les politiques 💼 traitent le crack à travers un discours dominé par l’exclusion 🚫, la répression et la stigmatisation ⚖️.
Le contraste avec le traitement de la cocaïne 💉 est frappant : on présente souvent celle-ci comme un problème relevant de la sphère privée 🔒, nécessitant une prise en charge de la personne dépendante.
Certes, « l’hystérie médiatique » autour de Pierre Palmade a mis en évidence la “dangerosité” de la conduite automobile sous cocaïne 🚗💨. Mais cette affaire a surtout donné lieu à un discours public axé sur l’obligation de soins 🏥 et le renforcement des sanctions ⚖️, en favorisant le cadrage sanitaire.

neanmoins,
Le crack, au contraire, fait l’objet le plus souvent d’un cadrage sécuritaire relevant de la gestion de « publics considérés comme indésirables » qu’il faudrait « enfermer » et mettre à l’écart.
Cette mise à l’écart est à la fois sécuritaire et sanitaire. Ainsi, de septembre 2021 à 2022, plusieurs centaines d’usagers de crack ont vécu dehors, dans un campement insalubre dénommé Forceval, porte de la Villette, entre Aubervilliers et Pantin, des communes limitrophes de Paris.

Dans les discours publics portés par le gouvernement, c’est la dimension ordre public qui domine. Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, très présent dans ce débat, a annoncé régulièrement « vouloir « frapper beaucoup plus fort » pour « éradiquer le crack ».
Dans ce contexte, la réponse politique a été de laisser ce camp subsister durant une année et de construire un mur à Forceval, sous la supervision de l’ancien préfet de police Didier Lallement. Qualifiée de « mur de la honte », cette construction a non seulement symbolisé la mise à l’écart des usagers de crack, mais aussi l’échec de l’État français dans sa politique des drogues.
Miser sur la réduction des risques plutôt que sur la répression
La stratégie politique mise en œuvre jusqu’à présent laisse des usagers de crack et des habitants des quartiers populaires vivre dans des espaces de non-droit. Cela constitue une violence d’État vis-à-vis de publics fragiles.
Cette politique répressive accentue les dommages, les désordres et les souffrances, tant pour les usagers que pour les riverains. Elle mène à une impasse, symbolisée par le mur de Forceval.
Preuve de son inefficacité, les scènes ouvertes se disséminent aujourd’hui dans différentes villes de France, comme à Bordeaux par exemple.
Pourtant, d’autres solutions existent, qui permettraient de pallier cet échec. Elles nécessitent de repenser les politiques des drogues à partir d’une approche de réduction des risques qui promeut la santé, le soin, l’inclusion sociale et la capacité d’agir des usagers et la pacification de l’espace public pour les riverains.
Mal connues en France, ces politiques ne s’opposent pas au sevrage. S’inscrivant dans une démarche de soin, elles sont complémentaires de la lutte contre les trafics. Elles ont fait la preuve de leur efficacité pour mettre fin aux scènes ouvertes de consommation chez nos voisins européens
Les cas de la Suisse et du Danemark
Dès 1986, la Suisse a mis fin aux scènes ouvertes qui rassemblaient des milliers d’usagers consommant à ciel ouvert dans des parcs de Zürich ou de Berne grâce à une politique de réduction des risques volontariste et à l’ouverture de salles de consommation à moindre risque. Implantées aujourd’hui sur tout le territoire suisse, elles ont permis d’améliorer considérablement le quotidien des usagers de drogues et des habitants.
Le Danemark a également implanté des salles de consommation à moindre risque à Copenhague.
Ce pays scandinave a choisi d’inclure socialement les usagers en facilitant leur accès à l’hébergement. Il a également implanté ces dispositifs près d’espaces de sociabilité comme des bars, restaurants et salles de spectacle, où différentes populations se croisent.
Pour être efficaces, ces deux pays ont lancé des projets de collaboration entre la police et les travailleurs médico-sociaux. Ils œuvrent ensemble pour rendre la ville plus inclusive. Ils ont décidé que l’amélioration de la santé et de la situation sociale des usagers de drogues relève de la responsabilité de l’État et de la ville. Leur pari est que cela contribue aussi à pacifier la vie quotidienne des habitants.
La réduction des risques est une politique pragmatique qui profite à deux parties concernées par les scènes ouvertes de drogues : les usagers qui y vivent et les riverains proches.
Une demande de mise à l’abri
Dans mes terrains d’enquête sociologique, les entretiens menés avec les usagers de crack rendent compte de la dureté extrême de leurs conditions de vie à la rue et de l’opprobre social qu’ils subissent. Bon nombre d’usagers utilisent le crack pour supporter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et en particulier la violence de la vie à la rue.
Le crack permet de soulager les souffrances liées à des trajectoires de vie difficiles, les violences subies, d’oublier sa vie et le regard des autres le temps d’une consommation.
les discours
Les discours des usagers révèlent leur désir de sécurité. Ousmane, 40 ans, explique : « Cela fait 20 ans que je vis dans la rue… Je suis épuisé, je n’en peux plus de la rue, de tout ça… J’ai besoin d’un hébergement. » Un hébergement est essentiel pour prendre de la distance par rapport au produit qui envahit leur quotidien. David, 24 ans, partage : « Quand on est dans la rue, c’est la vadrouille parce qu’on n’a pas d’endroit où se poser. Alors, on passe nos journées à fumer du crack pour faire passer le temps. »
Ils parlent aussi de leur sentiment de respect dans les lieux de réduction des risques qui les accueillent. Ali, 43 ans, témoigne : « Ils nous offrent à manger, à boire, ce qui est très important. On peut s’asseoir, se regarder, il y a de la musique. En plus, on peut prendre une douche… C’est essentiel d’avoir le respect de la dignité. »
Lorsque les usagers de drogues reçoivent une prise en charge adaptée, les bénéfices sont visibles, à la fois pour eux et pour la communauté. Les scènes ouvertes disparaissent, et la prise en charge respecte les droits humains.
Une approche qui peine à s’imposer en France
cependant
L’arrivée du nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, en juillet 2022, a marqué un changement de discours sur le crack. À la veille de l’évacuation du camp de Forceval le 15 septembre 2022, il déclarait que « l’action ne peut pas être que policière et répressive, elle doit aussi être sanitaire et sociale ». Son discours s’aligne davantage avec celui de l’agence régionale de santé et de la ville de Paris, porté par l’adjointe à la santé, Anne Souyris, qui prône une approche de réduction des risques.
Espérons que ce soit un début de changement. À ce jour, le traitement politique des usagers de crack et des riverains des scènes ouvertes révèle des « hiérarchies morales » qui attribuent des valeurs différentes à la vie des personnes, comme le souligne l’anthropologue Didier Fassin. Cette situation met en lumière les failles de notre démocratie, qui peine encore à déployer les principes d’égalité, de liberté et de fraternité qui la fondent.
Découvrez des articles sur comment annoncer sa toxicomanie à ses proches et sur le rétablissement dans le champ de la santé mentale, pour mieux comprendre et accompagner ces parcours de vie.
✅ #AnalyseDiscoursPublics, ✅ #Cocaïne, ✅ #RéductionDesRisques, ✅ #PolitiquesPubliques, ✅ #SantéPublique, ✅ #Stigmatisation, ✅ #DépistageCocaïne, ✅ #MarieJauffretRoustide, ✅ #ConsommationDeDrogues, ✅ #PréventionCocaïne
Découvrez notre article sur la prévention de l’alcoolisme pour mieux comprendre les enjeux : Prévention de l’alcoolisme .
🔗 Marie Jauffret-Roustide – Analyse des discours publics sur la cocaïne
🔗 Réduction des risques liés à la consommation de cocaïne



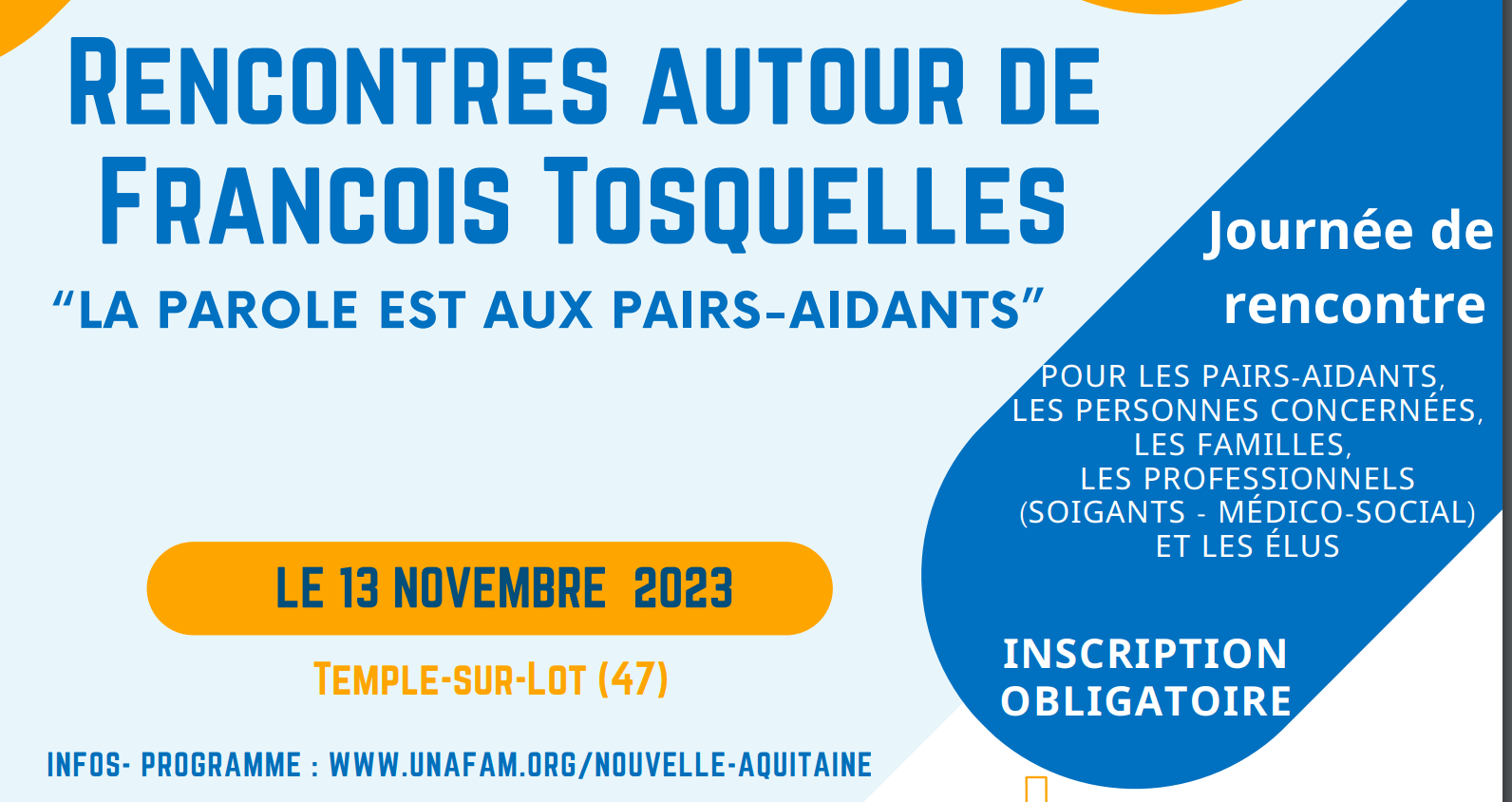
1 Comment
[…] des articles sur l’analyse du discours de Marie Jauffret sur la cocaïne, la Journée mondiale contre l’hépatite, pour des réflexions essentielles […]